Le château de Ferreyroles
|
Extrait de :
Louis Raymond
Le Barjaquès. Tome 1, Vallée de la
Cèze-Ferreyroles
Ed. Racines et Patrimoine Occitans, 1993 |
| |
|
|
Nous allons nous pencher
sur ce monument qui se trouve être un des anciens gardiens de la Cèze.
A travers l'histoire de ses seigneurs et de son mandement, on verra que
ce château féodal a marqué très fortement le Barjaquès. Depuis presque
un millénaire, il est toujours là sur son éperon rocheux, sentinelle de
pierres, verrouillant la vallée de la Cèze, dont la rivière, impétueuse
ou calme, suivant les saisons, coule à ses pieds de calcaire.
Défiant les siècles et leurs
turbulences, l'érosion qui, peu à peu, ronge les joints et la pierre, et
surtout les hommes, leurs bêtises et leur inconscience, car finalement
ce sont eux qui lui ont fait et qui continuent à lui faire le plus de
mal, il semble nous interpeller :
|
 |
|
Vue des murs nord et est.
On remarque la parfaite
rectitude des arêtes
des pierres
à bossage, ainsi que l'éperon |

|
| Au premier plan reste d'un mur de défense. Au deuxième plan l'arquebusière |
|
« Que faites-vous de moi
maintenant, moi qui ait protégé vos ancêtres, ne me laissez pas mourir.
Mon histoire est aussi la vôtre. Arrêtez de me faire souffrir ! »
Après
son abandon à la fin du 18e siècle, oublié par ses propriétaires
successifs, il devient une aubaine pour certains habitants des alentours
qui avaient sous la main une carrière gratuite, et surtout des pierres
ouvragées, dont on peut en reconnaître de nos jours dans certaines
constructions. Malgré l'injure du temps et des hommes, ce qui reste du
château originel ne manque pas de beauté architecturale. En effet, il a
sans doute été érigé au début du 12e siècle, à l'apogée de l'art roman
languedocien. Ce sont sans doute, les mêmes compagnons, bâtisseurs
d'églises, d'abbayes ou de chapelles rurales qui lui ont appliqué leur
art en nous léguant leur œuvre avec l'aide des architectes talentueux de
l'époque ; car, en effet, on ne peut manquer de rester admiratif devant
leur haute technicité et le savoir-faire de ces bâtisseurs, ouvriers
hors pairs. La taille des pierres et leur ajustement est si précis que
la jonction des murs nord et est présente une arête parfaitement
rectiligne. |
Malgré sa forme massive le château ne manque pas
d'élégance grâce à la construction en gros et moyen appareil de ses
pierres à bossages qui, suivant les saisons et la position du soleil,
dessinent des ombres portées cassant l'uniformité du mur, et qui sont
très agréables à l'œil, la lumière alternant avec des bandeaux ou des
triangles d'ombre.
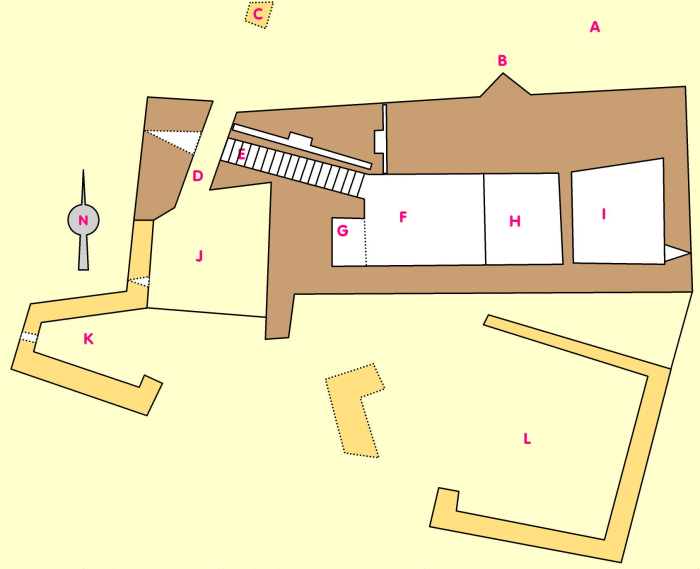 |
| |
Maçonnerie en grand appareil |
F |
1e
salle à étage avec reste de voûte |
| |
Maçonnerie en petits moellons |
G |
Citerne |
|
A |
Chemin
d'accès |
H |
2e
salle avec reste de croisée d'ogive |
|
B |
Eperon
oblique |
I |
3e
salle pièce voûtée avec archère |
|
C |
|
J |
Salle
voûtée en petits moellons avec meurtrière |
|
D |
Couloir
voûté plein ceintre avec meurtrière |
K |
Tour
avec fenêtre et latrine |
|
E |
Escalier à marches obliques |
L |
Ruine
de construction à deux niveaux |
|
|
Nous n'avons pas les dimensions de l'ouvrage mais nous sommes persuadés,
qu'étant donné l'harmonie des lignes et le rapport des dimensions si
parfaits, qu'il a été pensé et construit par des architectes ou des
compagnons sur la base de l'application du nombre d'or (1).
Situé au
milieu des gorges de la Cèze, à égale distance des châteaux de Tharaux
(2) et Montclus qui commandaient les deux entrées possibles de la
vallée, il constituait avec eux une admirable ligne de défense. De par
sa position stratégique il devait surveiller le passage du gué et de la
drailhe qui, de Méjannes allait rejoindre à Barjac le grand chemin (3)
menant aux Vans et aux Cévennes. Les troupeaux qui, à l'époque étaient
nombreux sur les plateaux de Méjannes et de Lussan, empruntaient cette
drailhe pour leur transhumance annuelle ; c'était plus court que de
suivre l'ancienne voie romaine. Il existait deux péages, un à Méjannes
et l'autre à Russargues ; d'ailleurs dans ce dernier hameau et à la
sortie, juste à la limite administrative actuelle entre les communes de
Barjac et de St Privat de Champclos, il y a une ancienne ferme qu'on
appelle le « piage » qui n'est que la déformation populaire du mot
« péage ». |
 |
| 2ème porte d'entrée du château avec le couloir oblique et la meurtrière
de la pièce du rez-de-chaussée. |
|
A ces divers péages, on acquittait différentes taxes de
marchandises, de passage des hommes et des animaux. La taxe de
circulation des troupeaux était appelée droit de pulvérage (4).
Le
château de Ferreyrolles devait avoir également une fonction de
surveillance des nombreux orpailleurs qui opéraient dans le lit de la
Cèze, car celle-ci a comme affluent la Ganière, rivière très aurifère
(5). Bâti sur un escarpement rocheux, dominant la rivière cévenole par
des à-pics de plus de 50 mètres, son emplacement exceptionnel a été
choisi de façon à ne présenter aux futurs assaillants, que le minimum de
murailles pouvant être atteintes par les boulets de pierre ou de fonte,
lancés par les engins balistiques de l'époque, baliste, catapulte,
mangonneau, etc.. Les côtés Sud, Ouest et partiellement Est par leurs
aplombs impressionnants, étaient pratiquement impossibles à atteindre
par une escaladé vertigineuse et vouée à l'échec. Cette forteresse
médiévale était presque imprenable ; on le verra plus loin, avec
l'épopée des Camisards. Le seul point faible était le côté Nord, qui
était légèrement dominé par la ligne de crête séparant deux talwegs (6),
sur laquelle serpentait le chemin menant au gué ; c'était aussi, la
seule possibilité d'accès au château par les deux portes qui étaient
percées dans ses murailles. La vulnérabilité du côté Nord fut compensée
par l'édification d'un mur très solide de prés de 2,50 mètres
d'épaisseur dont l'appareillage extérieur était constitué de pierres à
bossage, renforcé par un éperon oblique au tiers de sa longueur. Les
pierres à bossage étaient destinées à amortir l'impact des projectiles
sur les fortifications ; lorsque Ceux-ci atteignaient une construction
normale présentant une surface unie, ils finissaient par fendre puis
éclater les pierres. A force de « battre » au même endroit, la pierre
suivante subissait le même sort, jusqu'à ce qu'une brèche soit ouverte
dans la muraille. Il en est autrement des pierres à
bossage, car la force de percussion du projectile qui les atteint est
amoindrie par la partie saillante, et celui-ci est dévié, ne faisant
qu'ébrécher la saillie.
|
Contrairement à ce que peuvent penser certains
qui s'intéressent à l'histoire de ce château, le coût de construction de
cet ouvrage à l'architecture si plaisante, est très élevé ; en effet, à
la taille normale sur cinq faces de chaque pierre, il convient d'ajouter
la taille sur une face de façon à laisser une partie saillante, et c'est
là tout le savoir-faire des tailleurs de pierres.
Ce genre de
construction féodale des 12° et 13° siècles sera abandonnée au 14°
siècle, à la suite de l'apparition du canon, utilisé la première fois en
Europe, à la bataille de Crécy (7). L'accès actuel à l'intérieur du
château se fait par une ouverture percée dans la muraille en voûte plein
ceintre avec claveaux. Derrière cette baie, sur les côtés latéraux, on
remarque les trois évidements qui permettaient de loger les barres
consolidant la fermeture de la porte. Avant d'arriver sur le palier de
cette porte, on devait d'abord franchir une première porte qui était
percée dans une autre muraille, aujourd'hui disparue, et grimper un
escalier menant à la forteresse proprement dite. |

|
| Vue du couloir à partir de la première salle du rez-de-chaussée. |
|
Lorsque l'on franchit
cette ouverture, on débouche dans un couloir en
oblique, par rapport à la façade Nord, qui
desservait les pièces situées au sud et à l'est ; ce
couloir mesure environ 5 à 6 mètres de longueur sur
1 mètre de large. Il était également fermé côté Sud
par une porte dont il reste l'ouverture et également
les 3 évidements servant à loger les 3 barres de
renfort de cette porte. Sur la droite, en entrant,
se trouve une meurtrière qui permettait de lancer
des projectiles sur d'éventuels assaillants. En cas
de siège et si les défenses extérieures avaient
cédé, des défenseurs barricadaient les deux portes
Nord et Sud du couloir, jusqu'à ce que celles-ci
cèdent à leur tour.

|
| Meurtrière de la pièce voûtée du rez-de-chaussée |
|
Mais une fois dans le couloir les assaillants n'étaient pas au
bout de leur peine ; en effet il fallait qu'ils empruntent sur
la gauche, en entrant, un escalier très étroit, en oblique lui
aussi, ne permettant le passage que d'une seule personne (et
encore pas trop forte) ; cet escalier est construit à
l'intérieur du mur défensif et mène à la partie haute du
château. Le giron des marches est tellement faible, sans doute
pour ajouter à la difficulté des futurs assaillants de pénétrer
dans les pièces du haut, qu'on est obligé de poser le pied de
travers si on ne veut pas glisser. Dès
la fin de l'escalier on débouche dans une première salle au voûtement et
à la toiture effondrés ; sur la droite se trouve une citerne qui
recueillait les eaux pluviales de la toiture par un système de
canalisation. Malgré la proximité de la Cèze, cette citerne aurait rendu
les plus grands services en cas de siège du château. |
La première salle
est séparée de la suivante par une baie plein ceintre au voûtement
formidable et dont il ne subsiste qu'une partie latérale accolée au mur
Nord. Etant donné l'épaisseur de cette voûte, il nous semble que ce
n'était pas une simple toiture en berceau qu'elle devait supporter, nous
pensons soit à une volée d'escaliers permettant d'atteindre les parties
hautes, chemin de ronde, hourds, (8) etc.. ou à une construction
supérieure, genre tour, et qui devait dépasser largement du faîtage
actuel. La deuxième salle présente encore côté Nord, deux corbeaux (9)
de facture différente et qui semblent avoir été construits à des époques
indéterminées, ce qui laisserait supposer une modification ou des
réparations à la voûte de cette pièce. Une corniche court le long des
quatre murs, et dans l'angle nord-est un corbeau supporte un départ de
croisées d'ogives, qui a la particularité de présenter alternativement
les pierres d'arcade, cubiques ou nervurées. Le culot de ce corbeau
semble avoir reçu l'ébauche d'un écusson. Les voûtes et la toiture de
ces deux salles étant effondrées, il reste au sol une hauteur importante
de déblais, sans doute composés de pierres de petites dimensions, les
autres ayant été «emportées» pour des usages domestiques. C'est par une
grande baie voûtée que l'on pénètre dans la troisième salle ; celle-ci
est très belle, son voûtement en berceau plein ceintre intact, éclairée
faiblement par une magnifique meurtrière ou archère avec ébrasement
(10), percée dans le mur est.

|

|

|

|

|
L'entrée vu du couloir
avec
les 3 évidements |
La citerne |
Vue du couloir Escalier
donnant à l'étage |
Escalier vu
de l'étage
donnant sur le couloir |
1ère salle haute |
Là aussi on reste ébahi devant ce joyau architectural
; aucune pierre n'étant de la même dimension, et il a fallu les tailler
en dégradant pour finir par cette ouverture très étroite. Quel art ! De
cette meurtrière on pouvait observer discrètement une partie de la
vallée, et jeter éventuellement des projectiles. Les murs existants des
trois salles portent tous des évidements ou trous de boulins qui
devaient recevoir des poutres sur lesquelles étaient construits les
planchers.
On remarque aussi des niches aménagées dans les divers
murs, dont l'usage précis nous échappe ; à des fins domestiques ou
militaires ? Le sol de la troisième salle est constitué directement par
le sol naturel du rocher sur lequel est bâti le château ; il devait
certainement y avoir un pavement à l'origine, mais il a disparu lui
aussi. On quitte ces trois salles en pénétrant en hauteur sur un
monticule, sans doute ruines de la toiture effondrée, situé dans une
espèce de cour, sur lequel poussent de nombreux arbres. On remarque
aussitôt que ce qui reste des murs Sud et Est, présente une facture de
construction tout à fait différente. Ces murs en petits moellons
irréguliers semblent être postérieurs à la construction des murs
appareillés en pierres à bossage, ce qui ne manque pas de nous intriguer
et de se poser de multiples questions. Seule une analyse scientifique
des mortiers nous permettrait de dater précisément ces constructions de
moindre qualité qui semblent avoir été édifiées par des maçons locaux,
contrairement à la construction romane qui a sans doute été érigée par
des compagnons Lombards.

|

|

|
Vue sur la 2ème
et 3ème salle |
Vue sur le départ de voûte
arrachée séparant les 2
premières pièces du
haut.
En face l'escalier et
à gauche la citerne |
Voûtement de la 1ère
et de la 2ème salle |
Il semble qu'il y ait l'amorce d'un escalier
permettant d'atteindre la partie sommitale du château qui devait être
une vaste terrasse située au-dessus des voûtes, dont il subsiste encore
un fragment de dallage ; de fines rigoles permettaient de capter l'eau
de pluie et de l'acheminer à la citerne située au-dessous. Cette
terrasse devait être ceinturée par un mur, à hauteur d'hommes, avec
créneaux et merlons ; il est fort possible également qu'à l'extérieur
aient été aménagées des hourds. Au-dessus de cet ensemble devait
flotter la bannière des Seigneurs de Ferreyroles ou des de Barjac. Il
est certain que de cette terrasse rien ne pouvait échapper à la
vigilance des guetteurs dont la vue s'étendait très loin, en aval ou en
amont de la Cèze.

|

|

|

|
Les corbeaux de la 2ème
salle haute avec la corniche |
Voûtement avec
corbeau et niches de
la 2ème salle
haute |
Corbeau à culot et
croisée d'ogive avec
pierres nervurées et
cubiques de
la 2ème
salle haute |
Meurtrière en archere
à ébrasement de
la 3ème salle donnant
sur l'Est. |
Il subsiste encore de nombreux vestiges, en particulier sur la droite
avant de pénétrer dans le château, il y a une ancienne petite tour
percée d'une arquebusière (11) en direction du Nord ; au-dessus, il
devait y en avoir une autre qui, elle, devait regarder vers le Nord-Est
où devait probablement se trouver la première porte d'entrée située dans
le rempart, en avant du château, et défendre cette porte. Sous cette
tour, on remarque deux départs de voûtes ; une vers l'ouest, l'autre,
vers le Nord. Tout à fait au bas de la tour, il y a une petite salle à
la voûte plein ceintre de grande hauteur, avec deux niches dans son mur
sud, dont l'utilisation nous paraît mystérieuse. On remarque également
deux corniches à l'est et à l'ouest, et une profonde gorge en haut du
mur sud ; on dirait que l'usure de la pierre a été provoquée par un long
frottement.

|

|

|
Vue sur la petite salle
du dessous avec
les 2 niches, les
corniches et
la
gorge en haut du mur. |
Vue sur la Cèze
par la
brèche
dans mur Est |
Arquebusière
Tour avancée |
Cette salle était-elle la chapelle
seigneuriale ou bien l'église paroissiale de Ferreyroles mentionnée par
certains écrits ? Et, est-ce le frottement d'une corde actionnant une
cloche placée en haut de la tour qui a provoqué cette usure ? Sur la
droite de cette salle, il y a un mur assez haut dont l'appareillage
ressemble à celui des murs sud, parties est et ouest du château. Au bas
de ce mur et seulement visible de l'extérieur, il y a une meurtrière ;
l'épaisseur des déblais provenant de la destruction de ce mur, qui nous
paraît être une ligne de défense, a sans doute comblé une autre salle se
trouvant à la hauteur de la meurtrière. On remarque dans le rocher
supportant le château une petite ouverture ; il s'agit de l'entrée d'un
couloir naturel qui traverse tout le rocher et débouche sur le flanc de
celui-ci côté sud. Il y a les mêmes grottes côté est, dont parle Mr
Félix Mazauric. Le couloir, dont nous avons parlé plus haut, débouche
dans une salle voûtée mais d'appareillage non soigné ; il y a aussi dans
le mur de droite et presque au ras du sol une autre meurtrière. Cette
salle devait être fermée au Sud par un mur, aujourd'hui disparu, mais
d'où on découvre un très beau panorama sur la Cèze. A la droite et au
fond de la salle, il y a une autre construction en opus incertum (12),
genre de tours à 1 ou 2 étages. Au fond et à droite de cette tour et à
la hauteur d'un premier plancher (qu'il devait y avoir) on remarque une
cavité ; il s'agit tout simplement des latrines. Des vestiges actuels
et compte-tenu des démolitions effectuées par les habitants de la
région, on peut dire que le château devait être beaucoup plus important
que ce qu'il ne paraît. Des écrits corroborent cette supposition, en
particulier, les résultats de l'enquête effectuée le 22 Juillet 1322 par
le Commissaire Jean Bon, désigné par le Sénéchal de Beaucaire, à la
suite des lettres patentes datées du 5 Avril 1321 du Roi Charles le Bel,
demandant de procéder à la vérification des domaines royaux cédés par
son père à Guilhaume de Nogaret et Guilhaume de Plaisian : « A ouï
Imbert de la Calmette, damoiseau (13) qui a été baille du château de
Ferreiroles et son tènement, député par le Viguier (14) d'Uzès pendant 5
années et qui dépose que le Roy a haute justice sur 62 feux. Dit que le
Roy n'avait point de château aussi bon dans la viguerie d'Uzès, que pour
400 livres, il ne pourrait sans faire un pareil. Que le Roy à le droit
de chasse, la tête du sanglier, le quartier gauche du cerf, la pêche, et
le droit d'amasser de l'or dans la rivière de Cèze... » Si nous pouvons
comprendre les agissements des hommes au cours des 2 derniers siècles
motivés par des raisons économiques difficiles qui les ont conduit à se
servir, sans bourse déliée, et excuser leur comportement dû à
l'ignorance totale de la valeur historique et architecturale de ce
monument, il en est autrement aujourd'hui. En effet, il est difficile
d'admettre à notre époque, alors que les moyens de sensibilisation à la
sauvegarde de notre patrimoine ne manquent pas, le comportement de
milliers de ces « touristes » qui, chaque année, contribuent à la
détérioration de l'ouvrage, en grimpant partout et laissant sur les
pierres la trace de leur passage par ces horribles graffitis, lorsqu'ils
ne les descellent pas ! Nous avons tenté, hélas, sans succès de faire
comprendre qu'il était urgent de faire quelque chose pour arrêter ce
massacre et en entreprendre une restauration.
| |
|
|
Vue par contre-bas côté ouest. On distingue bien la différence
d'appareillage et la tour venant en flanquement. On distingue très bien
la meurtrière du couloir. |
 |
|
Car nous, nous considérons que nous sommes
plus dépositaires que propriétaires du patrimoine acheté ou hérité de
nos anciens, et que nous avons le devoir sacré de le protéger et de le
transmettre intact aux générations suivantes. Le jour où les hommes
plutôt que de thésauriser auront compris cela, un grand pas sera fait.
Pour terminer ce chapitre sur le château, je voudrais citer quelques
phrases du grand historien régional qu'est Pierre Clément, dans la
conclusion de son magnifique ouvrage sur les "Eglises Romanes oubliées
du bas Languedoc" : |
|
« Malgré leur bonne volonté, les services chargés de faire appliquer la législation sur les monuments historiques, ne disposent d'aucun moyen de coercition. L'impuissance de la Direction du Patrimoine s'est même accrue depuis la mise en place de l'Inventaire Général né sous le règne culturel d'André MALRAUX... L'inculture artistique des décideurs n'est un secret pour personne. Dans la majorité des cas, le classement d'un monument est considéré comme une calamité pour les élus locaux ... » Souhaitons une prise de conscience collective
afin de sauver nos divers patrimoines, avant qu'il ne soit trop tard. |
 |
Vue prise de
l'intérieur côté sud en
regardant le Nord. On remarque au
premier plan un
mur qui semble
avoir été le
limon des
escaliers
montant à la
partie
supérieure du
château, et une
niche. On remarque
l'arche plein
cintre de la
2ème salle, les
2 corbeaux et la
corniche, ainsi
que la partie de
l'ogive. |
Notes
| 1 |
qui correspond à
une proportion esthétique, que l'on obtient par la formule (1 +
racine de 5)/2 =1,618 environ |
| 2 |
Il ne subsiste
plus qu'un pan de mur qui a été restauré par la mairie. |
| 3 |
P. A.
CLEMENT « Les chemins à travers les âges ». |
| 4 |
du
latin pulvis, pulveris signifiant poussière, en
raison de la poussière soulevée par les troupeaux. |
| 5 |
C'est dans cette rivière qu'ont été trouvées les
plu grosses pépites d'or. |
| 6 |
Il y eut également une mine d'or, et le
permis de recherche dit d'Abeau attribué il
y a quelques années à une société, a
déclenché le rejet de la population,
craignant diverses pollutions. |
| 7 |
Combes du Duc et du Château. |
| 8 |
Le 26 Août 1346par Edouard III, Roi
d'Angleterre. |
| 9 |
Galerie de bois établie au
milieu des crénaux pour battre
le pied des murailles du
château. |
| 10 |
Pièce de bois métallique ou
pierre en saillie destinée à
supporter une poutre, au
tout autre charge. |
| 10 |
Ouverture par laquelle
on tirait avec un arc ou
une arbalète. |
| 11 |
Ce qui laisserait
supposer que cette
construction est
postérieure à
l'édification du
château. |
| 12 |
Appareillage de
blocs de pierre
d'importance et
déforme
irrégulière. |
| 13 |
Jeune
gentilhomme
qui n'était
pas encore
armé
chevalier. |
| 14 |
En
occitanie,
juge qui
rendait
la
justice
au nom
du Comte
ou du
Roi. |
|
|